La politique budgétaire
Un remède contre les ravages
de la COVID-19 sur la pauvreté

Le marché central de Djokoto, dans le sud du Togo, fourmille d'animation. Chaque jour, des centaines de personnes se rendent dans ce village de la préfecture de Yoto pour y acheter nourriture, vêtements et produits d'hygiène. C'est aussi là que bien des gens gagnent leur vie, à l’instar d’Adjelé Noumekpo, 41 ans et mère de quatre enfants.
Mais au début de l'année 2020, le silence s'est abattu sur le marché.
« Quand la COVID est arrivée, nous avons été bloqués à la maison. Personne ne pouvait venir acheter notre huile de palme au marché », raconte la commerçante en évoquant le confinement décrété pour stopper la propagation du virus.
Les allocations dont elle avait bénéficié au cours des deux années précédant la pandémie lui ont offert une planche de salut : grâce à ce programme de transferts monétaires, elle s'était constitué un petit matelas de sécurité qui lui a permis d’affronter les moments difficiles. Avec cet argent, elle a pu acheter quelques animaux pour démarrer une petite coopérative et des stocks supplémentaires de noix pour augmenter la production familiale d’huile de palme.
« Vu notre situation, on aurait touché le fond sans ces allocations. On ne s’en serait pas sortis. »

L'initiative dont a bénéficié Adjelé Noumekpo comme d'autres familles togolaises démontre que la politique budgétaire — à savoir l’usage des dépenses publiques et de la fiscalité pour influer sur l'économie — possède un potentiel énorme pour protéger les ménages contre les chocs et les aider à renforcer leurs sources de revenus. Pour autant, comme le montre une nouvelle étude de la Banque mondiale, les mesures budgétaires peuvent donner des résultats différents selon le lieu et la manière dont elles sont mises en œuvre.

L'édition 2022 du Rapport sur la pauvreté et la prospérité partagée propose la première analyse approfondie de l'impact de la pandémie sur la pauvreté dans les pays en développement et se penche sur le rôle de la politique budgétaire dans la protection des populations vulnérables. Elle constate que la réduction de la pauvreté dans le monde est au point mort et appelle les responsables politiques à corriger le tir de toute urgence.
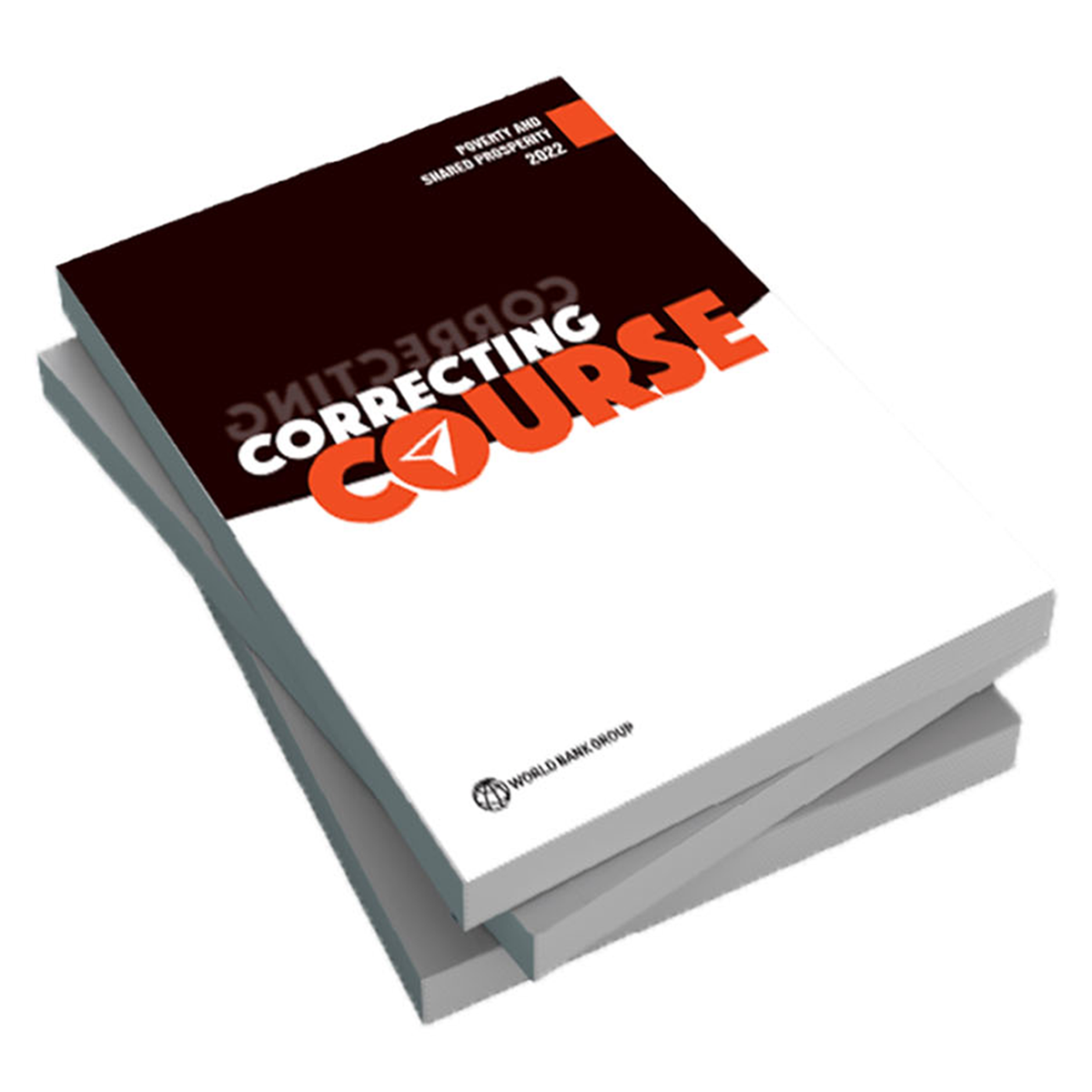
Des années de progrès effacées
La pandémie de COVID-19 est à l’origine de la pire régression dans la réduction de la pauvreté depuis des décennies.
Entre 1990 et 2019, le taux de pauvreté mondial avait chuté d'environ 40 % à 8 %, et plus d'un milliard de personnes avaient échappé à l'extrême pauvreté au cours de cette période. Mais les progrès soutenus accomplis entre 1990 et 2014 ont fortement marqué le pas dans les années suivantes, avant de tomber au point mort aujourd’hui. Le ralentissement de la croissance économique, les conflits, les effets du changement climatique et le fait que la pauvreté se soit concentrée dans des zones plus difficiles à atteindre sont autant de facteurs qui ont contribué à ce coup d'arrêt.
Puis la pandémie est survenue, et avec elle des conséquences dévastatrices. Fin 2020, le nombre de personnes vivant avec moins de 2,15 dollars par jour (ce qui correspond au seuil d'extrême pauvreté) a augmenté de près de 70 millions, soit la plus forte hausse annuelle depuis le début du suivi des chiffres de la pauvreté dans le monde, en 1990. Au total, 720 millions de personnes vivaient dans l'extrême pauvreté à la fin de l'année.
Les inégalités ont également progressé après plusieurs décennies de convergence. Ce sont les personnes les plus pauvres qui ont payé le plus lourd tribut à la COVID-19, en raison des pertes de revenus, des hausses de prix et des interruptions des services de santé et d'éducation. Qui plus est, depuis, la reprise économique a été inégale, les pays riches se redressant beaucoup plus vite que les économies à revenu faible et intermédiaire.
La guerre en Ukraine et l'augmentation des prix des denrées alimentaires et de l'énergie ont aggravé la situation. Au total, 685 millions de personnes pourraient vivre dans l'extrême pauvreté à la fin de cette année, soit près de 90 millions de plus par rapport à ce que l’on aurait pu espérer si le rythme de réduction de la pauvreté d’avant la pandémie s'était poursuivi. Si cette prévision se concrétise, il s'agira de la deuxième pire année depuis 2000 sur le front de la lutte contre la pauvreté dans le monde.
En conséquence, l'objectif d'élimination de l'extrême pauvreté d'ici à 2030 apparaît de plus en plus inatteignable. Près de 7 % de la population mondiale, c'est-à-dire environ 574 millions de personnes, continueront probablement à vivre dans l'extrême pauvreté en 2030. C'est plus du double des 3 % nécessaires pour atteindre l'objectif.
Les politiques budgétaires ont fait la différence
L'impact de la COVID-19 sur la pauvreté aurait été bien plus lourd en 2020 sans les mesures budgétaires prises à travers le monde, sous forme de programmes de transferts monétaires, de subventions salariales, d'allocations chômage, etc.
En septembre 2021, plus de 17 000 milliards de dollars, soit 20 % du PIB mondial de 2020, avaient été mobilisés pour la riposte budgétaire à la pandémie. Sans elle, le taux de pauvreté moyen dans les économies en développement aurait été supérieur de 2,4 points de pourcentage à ce qu'il était en 2020.
Le rapport montre toutefois que l'effet des mesures budgétaires a considérablement varié selon les pays.
La plupart des économies à revenu élevé ont réussi à compenser entièrement l'impact de la COVID-19 sur la pauvreté grâce à la politique budgétaire. Mais les économies à revenu intermédiaire de la tranche supérieure en ont compensé la moitié seulement, et celles à revenu faible et intermédiaire-inférieur, à peine un quart. En cause, un accès limité aux financements, des systèmes de prestation des services moins solides et des niveaux plus élevés d'informalité rendant beaucoup plus difficile la protection de l'emploi.
Avant même la pandémie, rares étaient les pays à revenu faible et intermédiaire qui utilisaient l'outil des transferts et subventions pour compenser le poids des impôts sur le revenu des familles. Dans deux tiers de ces économies, les ménages pauvres voient leur revenu disponible baisser du fait des impôts à payer et malgré les transferts et subventions perçus. Là encore, le niveau élevé d'informalité constitue un défi majeur : l'assiette fiscale étant limitée, ces pays optent généralement pour des impôts indirects tels que les taxes sur les ventes, qui tendent à bénéficier aux ménages les plus riches.




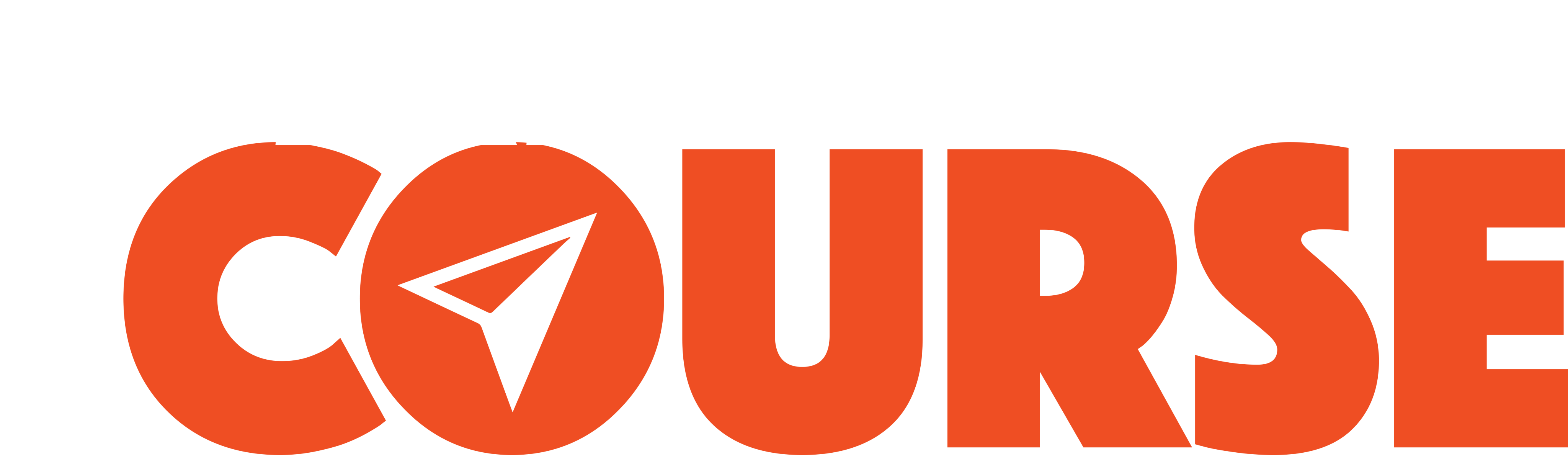
Dans ces conditions, que peuvent faire les pays pour relancer la dynamique de réduction de la pauvreté ?
Diverses mesures seront déterminantes pour parvenir à une reprise résiliente, la politique budgétaire jouant un rôle important. Le rapport recense trois grandes actions prioritaires dans ce domaine pour les prochaines années :
1. Axer les aides sur les citoyens pauvres et vulnérables, et éviter les subventions
Plus de 90 % des pays qui ont pris des mesures budgétaires rapides en réponse aux récentes crises des prix alimentaires et énergétiques ont recouru à des subventions. Pourtant, outre la distorsion des prix qui en résulte avec un impact négatif à long terme, les subventions profitent souvent aux ménages les plus aisés. Ainsi, la moitié des dépenses consacrées aux subventions à l'énergie dans les économies à revenu faible et intermédiaire bénéficient aux 20 % les plus riches de la population, qui consomment le plus d'énergie.
En revanche, les programmes tels que les allocations monétaires ciblées ont beaucoup plus de chances d'atteindre les ménages pauvres et vulnérables. Plus de 60 % des dépenses consacrées à ces transferts vont aux 40 % les plus pauvres et il est de plus en plus évident que cette mesure est avantageuse à long terme, en permettant par exemple aux familles de faire des investissements essentiels comme l'éducation de leurs enfants.

2. Investir pour favoriser le développement à long terme
Certaines des dépenses publiques les plus fructueuses — telles que les investissements dans l'éducation des jeunes ou dans les infrastructures et la recherche et développement — auront un effet bénéfique sur la croissance, les inégalités ou la pauvreté des dizaines d'années plus tard.
En période de crise, il est difficile de préserver ces investissements, mais c'est pourtant essentiel. La COVID-19 a montré que les progrès durement acquis au fil des décennies peuvent être balayés brutalement. Concevoir aujourd'hui des politiques budgétaires tournées vers l'avenir peut aider les pays à être mieux préparés et protégés contre les crises futures.

3. Augmenter les recettes fiscales sans pénaliser les pauvres
Les impôts fonciers, les taxes sur le carbone ou encore les droits d'accise sur les produits nocifs pour la santé peuvent permettre aux États d’accroître leurs recettes sans nécessairement faire peser la charge sur les pauvres. Rendre l'impôt sur le revenu des personnes physiques et des sociétés plus progressif est un autre levier. En outre, les progrès de la technologie numérique rendent souvent la mise en œuvre de ces réformes plus facile et moins coûteuse qu'auparavant.
Si les impôts indirects doivent néanmoins être augmentés, les pays devraient simultanément recourir à des transferts monétaires afin de compenser leurs effets sur les ménages les plus vulnérables.

Si elles sont mises en œuvre aujourd’hui, des réformes budgétaires ambitieuses destinées à promouvoir la croissance tout en réduisant les inégalités pourraient ramener les dynamiques de réduction de la pauvreté aux niveaux d’avant la pandémie.
Il faudra déployer des efforts colossaux pour opérer et mettre en œuvre les choix de politique budgétaire qui permettront de résorber, au cours des quatre à cinq prochaines années, les pertes causées par la pandémie. Et, quand bien même on y parviendrait, cela ne suffirait probablement pas pour se remettre sur les rails et mettre fin à la pauvreté d’ici à 2030. Mais ce n’est pas une raison pour procrastiner, bien au contraire : même si ces mesures s’avèrent insuffisantes pour atteindre l’objectif de 2030, elles doivent être engagées dès maintenant afin de répondre aux multiples crises d’aujourd’hui et de jeter les bases d’une redressement durable.
Même les initiatives les plus modestes, lorsqu’elles sont bien conçues et mises en œuvre, ont des chances d’avoir un impact réel sur des familles comme celle d’Adjelé Noumekpo.
Sans les deux années de transferts monétaires réguliers dont elle a bénéficié, sa famille aurait sombré pendant les moments les plus durs de la pandémie. Aujourd'hui, la commerçante se réjouit de l'essor de l'entreprise familiale.

« Pour la première fois, mon mari et moi avons commencé à compter l'argent gagné. C'était un petit bénéfice, mais pour nous, ça avait beaucoup de valeur. »
Les leçons de la pandémie
Plus de deux ans après le début de l'épidémie de COVID-19, une analyse des mesures mises en œuvre pendant la crise sanitaire permet de dresser un nouveau bilan des ripostes budgétaires et de leur impact sur la pauvreté.
Des aides retirées prématurément
Les dispositifs de soutien ont été supprimés trop rapidement pour certaines catégories de population vulnérables dont les niveaux d’emploi et de revenu en 2021 et 2022 étaient encore nettement inférieurs à ceux d’avant la pandémie. La hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie a pénalisé nombre de ces ménages, notamment les pauvres des zones urbaines.
La durée moyenne des programmes de soutien était de quatre mois et demi, mais la plupart d'entre eux ont été appliqués moins de trois mois. Près de la moitié des nouveaux dispositifs prévoyaient des transferts ponctuels et 20 % environ seulement des programmes étaient encore en vigueur au début de l'année 2022.
Remédier aux défaillances du marché
Pour relancer la croissance économique dans les pays qui peinent à se remettre de la pandémie, il ne faut pas tant dépenser plus que dépenser mieux. Il est souvent plus rentable à long terme de consacrer des ressources à la correction des défaillances du marché que de verser des subventions.
Par exemple, les subventions aux intrants peuvent augmenter la production agricole à court terme, mais elles risquent aussi d'amplifier les distorsions du marché. Des politiques de vulgarisation agricole et d’aide à la commercialisation bien conçues peuvent accroître l’investissement et la productivité des petits exploitants et entraîner une augmentation à long terme des revenus.

